Scoops à Moscou
par Olivier Rogez
La voix est l’essence de la radio, les mots sont sa raison d’être. Mais peut-on croire les mots sur parole ? En plusieurs occasions, il m’est arrivé d’en douter.
Ce fut le cas à Moscou, en septembre 1991. Alors que les ultras du camp communiste avaient tenté en vain de renverser le président soviétique Mikhaïl Gorbatchev, le pouvoir est resté quasiment vacant plusieurs semaines. Moscou était une ville ouverte. On y faisait ce que l’on voulait. Il n’y avait plus d’autorités pour interdire aux journalistes d’aller là où ils le souhaitaient.
Après être convenu d’un rendez-vous avec la direction, je me suis rendu à l’institut Serbski, l’hôpital où étaient internés les dissidents que le régime assimilait depuis toujours à des fous. À la fin de la visite, on m’a présenté un homme enfermé dans une cellule sécurisée aux murs jaunis par le temps et aux fenêtres munies de barreaux.

L’homme était torse nu, assis sur une chaise. Son visage inexpressif et ses yeux éteints trahissaient la camisole chimique qui enserrait son esprit. La directrice de l’Institut Serbski m’a expliqué qu’il s’agissait du premier « sérial killer » (en anglais dans le texte) soviétique.
Le boucher de Rostov
Andreï Tchikatylo avait tué et dépecé plus de soixante adolescents en un quart de siècle, ingérant tout ou partie de leurs organes. L’homme était inerte, incapable de parler. Je n’avais ni l’autorisation, ni l’envie de lui poser la moindre question. J’ai regardé pendant cinq minutes environ ce qui restait d’un homme devenu l’incarnation du mal absolu. À Moscou, personne n’avait jamais entendu parler de lui. Ni la presse soviétique, ni les correspondants occidentaux dans la capitale. On ne connaitrait son histoire que six mois plus tard lors du retentissant procès de celui que la presse appellerait ensuite le boucher de Rostov, du nom de sa ville natale.
Comment raconter cette histoire à la radio ? Qui allait me croire ? Je n’étais qu’un journaliste débutant, sans beaucoup d’expérience. Je craignais que l’on me rît au nez. Ce ne fut pas le cas. Le chef du service International de RFI, Pierre Benoît, et son adjoint, Jean-Pierre Boris, m’ont fait confiance. Ils ont diffusé mon papier.
Ce jour-là, le poids du journalisme m’est tombé dessus, j’ai compris l’immense responsabilité qui était maintenant la mienne. J’ai aussi mesuré la foi qu’avaient mes collègues de RFI en leur métier et le respect qu’ils vouaient à ses règles dont ils estimaient que nous étions tous les dépositaires et les vigies éclairés.
Durant ce même mois de septembre 1991, décidément historique, il m’est arrivé ce qui n’arrive jamais. Un hasard incroyable, presque brutal, une histoire si rocambolesque qu’elle est à peine crédible. Je souhaitais visiter les quartiers de Moscou réservés à l’élite, ceux où les dirigeants vivaient, disait-on, dans un confort royal en comparaison des conditions de vie misérables des soviétiques moyens.

Une collègue de RFI, Véronique Moreau, m’avait mis en contact avec un jeune photographe russe qui m’a conduit dans une ville de banlieue réservée à l’élite du KGB. Autrefois interdite aux visiteurs, elle était d’accès libre depuis le coup d’état raté contre Gorbatchev. Nous nous y sommes rendus sans rencontrer le moindre policier, ce qui était parfaitement incongru pour mon collègue photographe. Au hasard, nous avons garé la voiture dans une allée bordée de villas cachées par de hauts murs d’enceinte. À première vue, je tenais mon reportage sur cette nomenklatura vautrée dans le luxe.
Rencontre avec un espion
Il me restait à faire parler quelqu’un. L’allée était déserte. J’ai frappé à plusieurs portes. Après quelques tentatives, un homme manifestement ivre nous a laissé entrer chez lui. Je vous passe les détails, mais j’ai compris assez vite que cet homme était un étranger. Il m’a montré des papiers d’identité et quelques diplômes américains. J’étais en compagnie du seul espion américain ayant jamais fait défection à l’Est, si l’on excepte les agents doubles !
Il s’appelait Edward Lee Howard. Lorsque qu’il a dessaoulé et compris que j’étais vraiment celui que je disais être, c’est-à-dire un journaliste français, et que le jeune Russe avec moi n’était qu’un simple photographe de presse, il a pris peur et nous a demandé de partir.
Nous sommes rentrés à Moscou et nous avons raconté toute l’histoire à un journaliste du magazine Newsweek avec lequel le jeune photographe collaborait occasionnellement. J’ai vu la mâchoire de l’américain saisie de stupeur quand nous lui avons dit avoir rencontré Edward Lee Howard. Lui savait qui était cet homme au sujet duquel nous ignorions pratiquement tout. Il nous a raconté l’histoire d’Edward Lee Howard, nous promettant la gloire médiatique si nous parvenions à photographier l’espion et lui arracher quelques mots.

Nous sommes donc retournés quelques jours plus tard à son domicile. Il faisait son jogging dans l’allée. Howard nous a reconnu et nous a supplié de le laisser tranquille car il avait un fils en Amérique qu’il parvenait à voir une ou deux fois par an en Europe du Nord (ce que j’ai vérifié par la suite). Il ne voulait pas l’on parle de lui afin de ne pas hypothéquer ses chances de revoir son enfant. Entre nous et la gloire médiatique, il n’y avait qu’une photo. Une simple photo. Il nous la fallait quitte à la prendre à la sauvette.
Renoncer au scoop
Il tremblait de peur et nous nous sommes regardés. Nous n’avions pas envie de nuire à cet homme qui nous semblait déjà dans l’antichambre de la mort. Nous sommes rentrés à Moscou sans avoir pris la photo. Dans la voiture, j’ai demandé au photographe s’il avait compris qu’il venait de perdre plusieurs milliers de dollars. Il m’a souri. « Kanienchna ». Bien sûr. J’étais à la fois fier de mon attitude et déçu d’avoir laissé filer un tel scoop.
Cette histoire était si incroyable que j’hésitais à en parler à RFI. J’entendais déjà les railleries. « Il boit trop de vodka Rogez, faut le faire rentrer. » Ou encore, « il a trop d’imagination pour un journaliste ». Pourtant, Pierre Benoit m’a laissé la raconter à l’antenne dans un texte d’une minute et trente secondes environ.
Je n’ai jamais osé lui demander ce qu’il en avait pensé par peur d’entendre dans sa voix une intonation incrédule. Je n’en ai jamais parlé avec lui après mon retour en France. Il n’a jamais su les détails de cet épisode incroyable Mais il m’a fait confiance. Je suis sans doute passé à côté du scoop de ma vie, et ce, à un âge où il aurait eu un impact sur ma carrière. Cependant, j’avais reçu et compris de mes chefs à RFI la seule, la vraie et la plus indispensable des leçons. La confiance se gagne, elle ne s’usurpe pas.
L’auteur
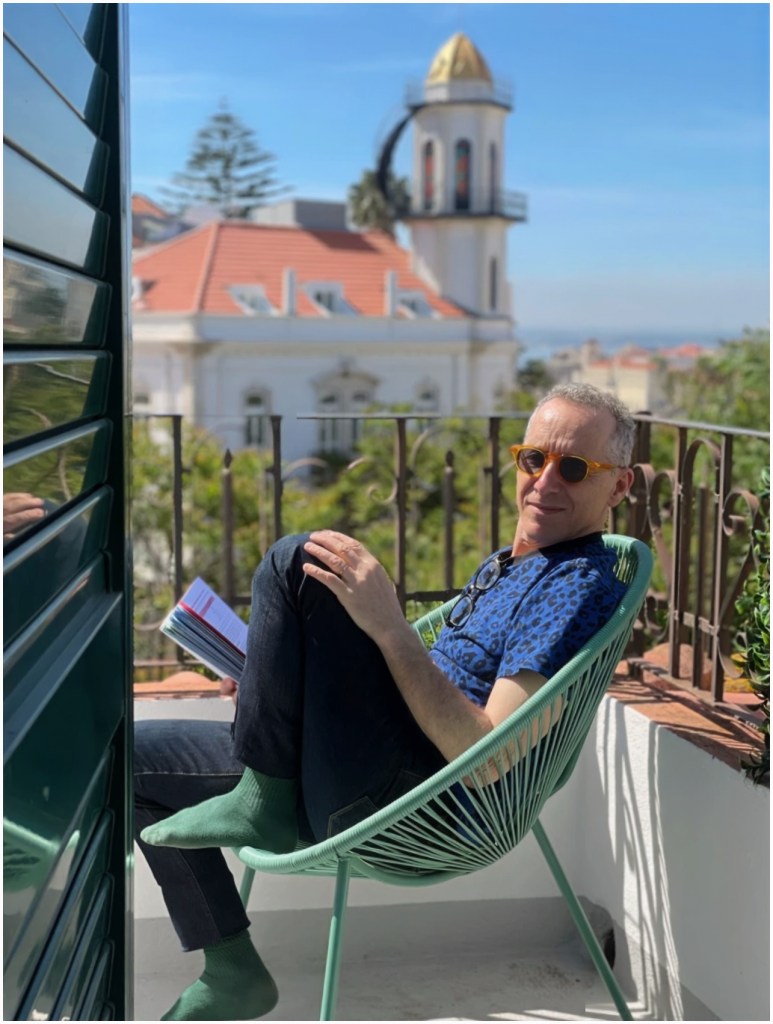
Olivier Rogez
Né en février 1965 à Roubaix
Etudes d’économie et de sciences politiques.
Diplômé du Centre Universitaire d’Enseignement du Journalisme (CUEJ) à Strasbourg en 1990
De 1992 à 1997, correspondant pigiste à Moscou
1997 : CDI à RFI
































Laisser un commentaire